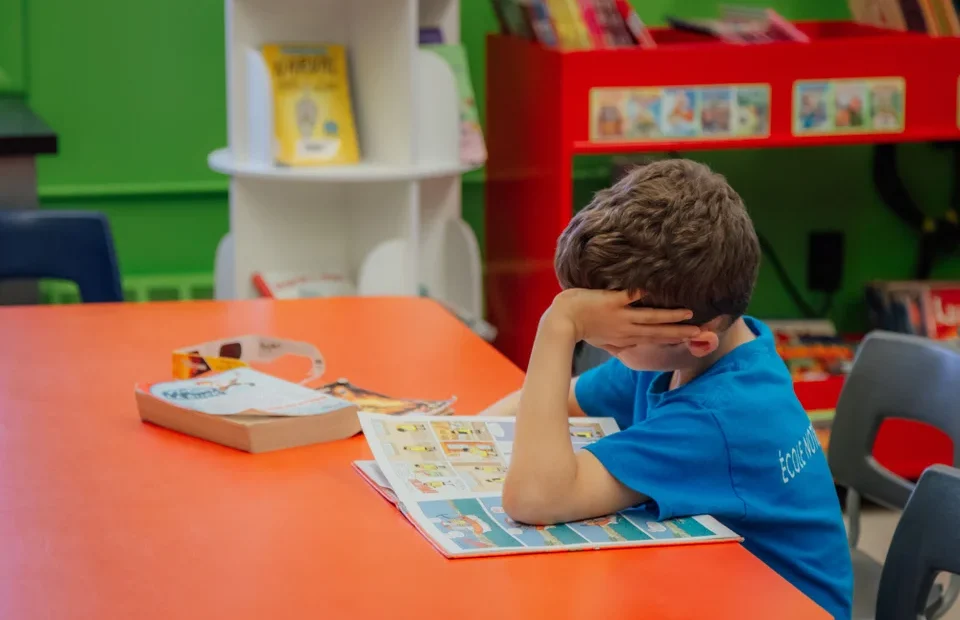
Ruptures de services scolaires : un échec collectif inacceptable envers nos enfants handicapés
Chaque fois qu’un enfant est renvoyé à la maison parce que l’école « n’est pas en mesure de répondre à ses besoins », c’est bien plus qu’un horaire chamboulé : c’est un droit fondamental qui est bafoué. C’est la société qui abdique sa responsabilité d’assurer à chaque élève — peu importe ses limitations — un accès égal à l’éducation.
Selon les données rapportées par Le Devoir, le nombre d’élèves en rupture de services scolaires a plus que doublé en cinq ans, passant de 1 481 en 2021 à 3 417 l’hiver dernier. Et encore : ces chiffres ne représentent que « la pointe de l’iceberg ».
Derrière ces statistiques froides, il y a des enfants en détresse, des parents à bout de souffle et un réseau scolaire qui se désagrège au détriment des plus vulnérables.
Une crise systémique, pas une série d’exceptions
Ces ruptures de services ne sont pas des incidents isolés : elles sont le symptôme d’un système éducatif à deux vitesses. D’un côté, des enfants qui bénéficient d’un encadrement adéquat; de l’autre, ceux qu’on renvoie à la maison faute de ressources, d’adaptation ou de volonté institutionnelle.
L’État québécois a l’obligation — légale et morale — d’assurer la fréquentation scolaire des enfants handicapés, comme le stipule la Loi sur l’instruction publique. Refuser ou suspendre les services éducatifs constitue une forme de discrimination contraire à la Charte des droits et libertés de la personne.
Pourtant, dans plusieurs écoles, ces violations sont banalisées. On parle pudiquement de « situations complexes » ou de « réorganisation temporaire ». Mais pour les familles concernées, ce sont des semaines — parfois des mois — de rupture, d’isolement et de déscolarisation.
L’exclusion invisible : quand les chiffres mentent
Le ministère de l’Éducation ne comptabilise pas les exclusions de moins de deux semaines, ni les horaires réduits imposés sans consentement parental. Ces « ruptures invisibles » sont pourtant quotidiennes :
- des parents appelés à venir chercher leur enfant en plein avant-midi;
- des élèves scolarisés seulement trois jours par semaine;
- des services d’orthopédagogie ou de TES suspendus faute de personnel.
Cette réalité dévastatrice, que les données officielles occultent, mine le développement des enfants et affaiblit les familles. Plusieurs parents doivent réduire leurs heures de travail ou quitter leur emploi, souvent sans soutien du CIUSSS ni compensation.
Comment parler d’inclusion quand l’école elle-même ferme ses portes à ceux qui devraient en être le cœur?
Ce que le gouvernement doit faire mieux — maintenant
Les solutions existent. Ce qui manque, c’est la volonté politique et la coordination intersectorielle.
Le ROPHCQ croit qu’il faut des actions immédiates et structurantes :
- Reconnaître la rupture de services scolaires comme une atteinte au droit à l’éducation.
Le ministère doit imposer des mécanismes de reddition de comptes aux centres de services scolaires et rendre publiques les données réelles sur les exclusions, officielles et non officielles. - Instaurer un cadre d’action pour prévenir les ruptures.
Chaque école devrait avoir l’obligation de mobiliser une équipe multidisciplinaire (TES, psychoéducateur, direction, parents, CIUSSS) avant d’envisager une exclusion. - Financer à hauteur des besoins réels.
Les ressources humaines spécialisées doivent croître au même rythme que la hausse du nombre d’élèves HDAA. Il est inacceptable qu’un manque de TES ou d’éducateurs spécialisés mène à l’exclusion d’un enfant. - Assurer la continuité éducative avec les CIUSSS.
Lorsqu’un élève est temporairement retiré, un plan d’intervention partagé doit garantir le maintien des apprentissages et des services. - Renforcer la participation des parents et des organismes communautaires.
Les décisions qui affectent la scolarisation d’un enfant doivent se prendre en partenariat, avec transparence et respect des droits parentaux.
Une question d’équité et de dignité
Le Québec aime se dire une société inclusive. Pourtant, chaque rupture de services est une brèche dans cette promesse collective. L’inclusion ne peut pas être un mot creux dans un plan d’action ministériel : elle doit se vivre au quotidien, dans les écoles, les classes et les services de garde.
Au ROPHCQ, nous refusons que l’exclusion des élèves handicapés devienne une normalité administrative.
Nous appelons le gouvernement, les centres de services scolaires, les directions et les conseils d’établissement d’école à agir avec courage, humanité et rigueur.
Parce que chaque jour d’école compte, surtout pour celles et ceux à qui on a trop souvent fait comprendre qu’ils n’y avaient pas tout à fait leur place.
